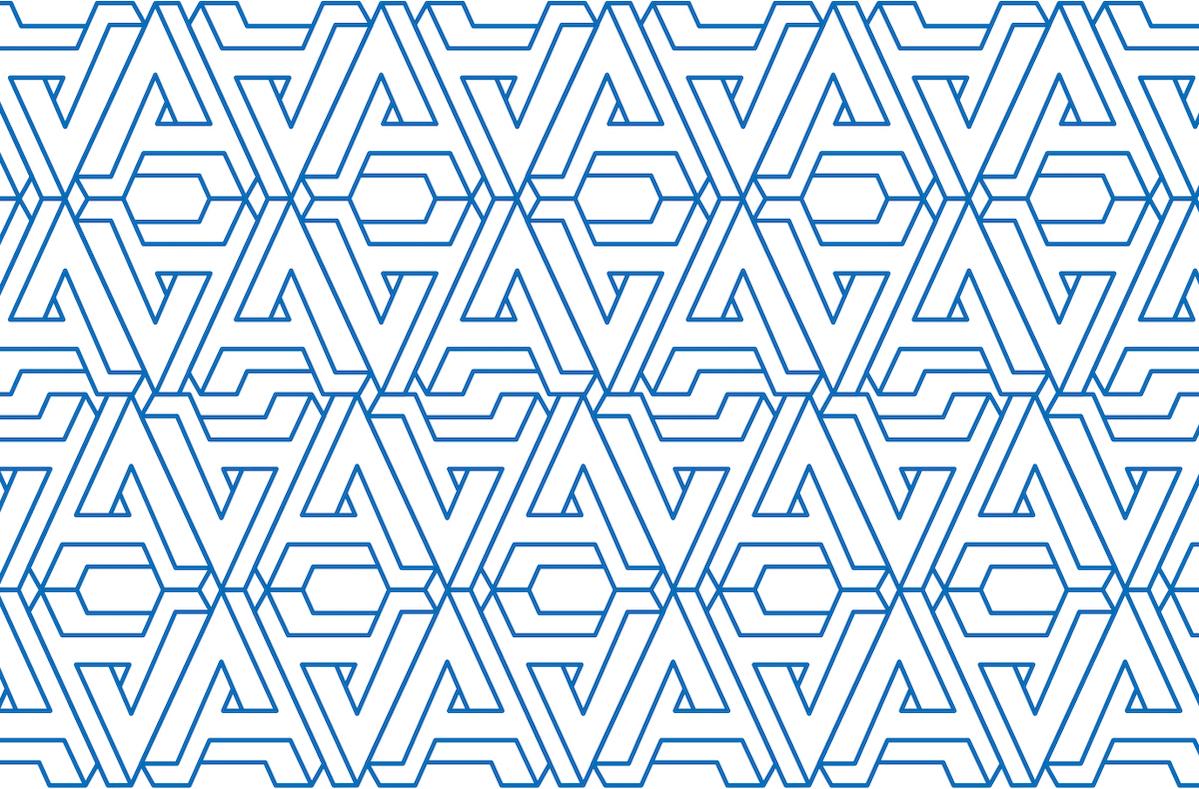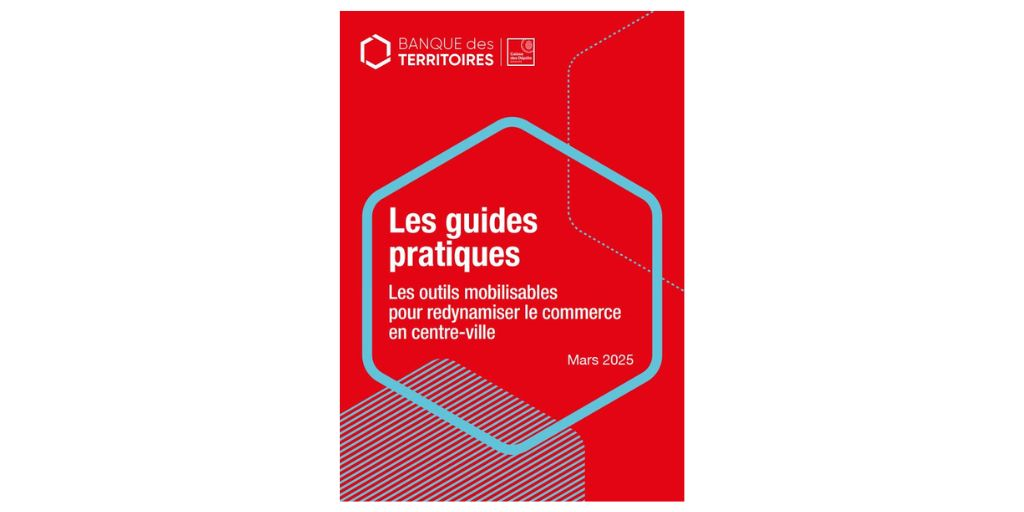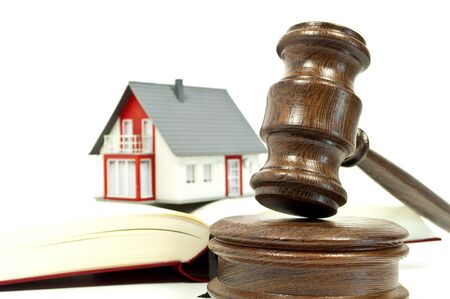
Catégorie
Date
Temps de lecture
CE avis. 24 juillet 2025, req. n° 503768
Par un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat juge que l’exercice des pouvoirs de police prévus aux articles L. 481‑1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, permettant d’ordonner la régularisation ou la mise en conformité de travaux irrégulièrement entrepris ou exécutés, est enfermé dans un délai sexennal. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative doit notamment tenir compte des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Si les travaux ne peuvent être régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité ne peuvent cependant porter que sur ces travaux.
Les propriétaires d’un cabanon – édifié irrégulièrement – faisaient construire une clôture en bois sur la même parcelle.
Par un arrêté interruptif de travaux pris par le maire et un courrier du 21 juin 2023, celui‑ci les a mis en demeure d’enlever sous un mois la clôture en bois et de démolir ledit cabanon sous astreinte.
Cette mise en demeure était fondée sur l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit essentiellement que lorsque des travaux ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme ou relatives aux autorisations d’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions imposées par une telle autorisation, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé : soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée (y compris par voie de démolition) ; soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
En revanche, ce texte ne prévoit pas expressément un délai de prescription encadrant la possibilité pour l’autorité administrative d’user de tels pouvoirs.
Devant se prononcer sur l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux et du courrier de mise en demeure de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte journalière, le tribunal administratif de Montpellier a en conséquence formulé une demande d’avis le 10 avril 2025 au Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article L. 113‑1 du code de justice administrative. La Haute juridiction devait ainsi se prononcer sur les questions suivantes :
D’une part, une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480‑14 du code de l’urbanisme, pourrait‑elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme, en vertu d’un principe général du droit ? Si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) ?
D’autre part, le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme ?
1 – S’agissant de la première question, et à titre liminaire, le Conseil d’Etat relève que le législateur a entendu attribuer aux maires des instruments plus efficaces qu’une action devant le juge pénal ou devant le juge civil afin de faire respecter la règlementation urbanistique.
L’autorité administrative peut ainsi mettre en demeure l’intéressé de procéder aux opérations de mise en conformité ou de régularisations nécessaires, le cas échéant à peine d’astreinte, après l’avoir invité à présenter ses observations.
A noter que depuis la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024, l’administration peut, en outre, dans certains cas procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de cette personne.
L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme prévoyant l’ensemble de ces mesures sans les encadrer expressément dans un délai de prescription, la question était donc de savoir si un tel délai devait néanmoins être consacré par le juge et si oui, lequel.
Dans ses conclusions, le rapporteur public du Conseil d’Etat estime, pour plusieurs raisons, qu’une imprescriptibilité de l’action administrative ne peut qu’être écartée. Il serait incohérent qu’une construction bénéficiant de la prescription administrative posée à l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme (qui, sauf exceptions, interdit au maire de refuser un permis de construire pour des travaux portant sur une construction existante irrégulière lorsque celle-ci est achevée depuis plus de dix ans) puisse, a posteriori, faire l’objet d’une démolition.
Egalement, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, dont l’article L. 481-1 est issu, que l’objectif était de permettre aux maires d’agir avec célérité pour assurer le respect de la règlementation. L’absence de délai d’action était, a fortiori, contradictoire avec cela.
En outre, les actions civile et pénale en telle situation sont, elles, enfermées dans un délai, respectivement, de dix et six ans. L’imprescriptibilité de l’action administrative serait, dès lors, difficilement justifiable.
En tout état de cause, la sécurité juridique commandait de mettre un terme à cette imprescriptibilité.
Aux fins de dégager un délai de manière prétorienne, le rapporteur public, M. Florian Roussel, rappelle justement que les autres actions, civiles et pénales, permettant d’imposer la mise en conformité des constructions, ne peuvent être exercées que dans des délais déterminés :
- Six années révolues à compter de la date d’achèvement des travaux, dans le cas de l’action pénale, en vertu de l’article 8 du code de procédure pénale, applicable aux délits ;
- Dix ans à compter de cette même date, en ce qui concerne l’action civile prévue à l’article 480‑14 du code de l’urbanisme.
La Haute juridiction administrative estime qu’un délai sexennal doit être retenu. Ce choix s’explique par le fait que l’administration doit, au préalable dresser un procès‑verbal d’infraction. Or, comme le souligne le rapporter public, « à quoi bon constater une infraction pénale si l’on sait celle‑ci déjà prescrite ? ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat en déduit que le législateur a exclu le fait que l’action administrative puisse être mis en œuvre au‑delà du délai de prescription de l’action publique. Et il précise, à cet égard, que :
« Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux. »
2 – La seconde question posée au Conseil d’Etat portait sur l’articulation du délai de prescription ainsi consacré avec la prescription dite « administrative » définie à l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme.
Ce texte prévoit que « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme » ; sauf dans un certain nombre d’exceptions, notamment « Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
La question de l’articulation se pose ainsi lorsque l’infraction constatée résulte de nouveaux travaux réalisés sur une construction existante édifiée également irrégulièrement.
Le Conseil d’Etat juge à cet égard que :
« Dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité administrative compétente doit notamment tenir compte de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que, lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux. »
Le fait qu’en cas de travaux sur une construction irrégulière, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable doive porter sur l’ensemble de la construction (ou l’ensemble des éléments irréguliers) est une solution ancienne 1)Voir notamment CE 16 mars 2015 M. et Mme de La Marque c/ Commune de Saint-Gervais-les-Bains, req. n° 369553 : RDI p. 316, concl. Decout-Paolini..
Compte tenu des dispositions de l’article L. 421-9, qui prévoient déjà la régularisation des travaux irréguliers réalisés depuis plus de dix ans, sauf s’ils ont été réalisés en l’absence du permis requis, les travaux irréguliers à régulariser ne seront, d’une part, que ceux réalisés depuis moins de six ans et visés par la mise en demeure fondée sur l’article L. 481-1 et, d’autre part, les travaux réalisés depuis plus de six ans et qui, ne pouvant bénéficier de la prescription de l’article L. 421-9, resteraient à régulariser (soit parce qu’ils ont été achevés il y a moins de dix ans, soit parce qu’ils ont été achevés il y a plus de dix ans mais sans le permis de construire requis).
Si l’ensemble des travaux à régulariser ne peuvent être autorisés (parce que les règles en vigueur ne le permettent pas), la seule solution sera leur mise en conformité.
Mais dans ce cas, compte tenu de la prescription de six ans applicable à l’article L. 481-1, cette mise en conformité ne pourra, elle, porter que sur les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite (c’est-à-dire ceux achevés depuis moins de six ans).
References
| 1. | ↑ | Voir notamment CE 16 mars 2015 M. et Mme de La Marque c/ Commune de Saint-Gervais-les-Bains, req. n° 369553 : RDI p. 316, concl. Decout-Paolini. |