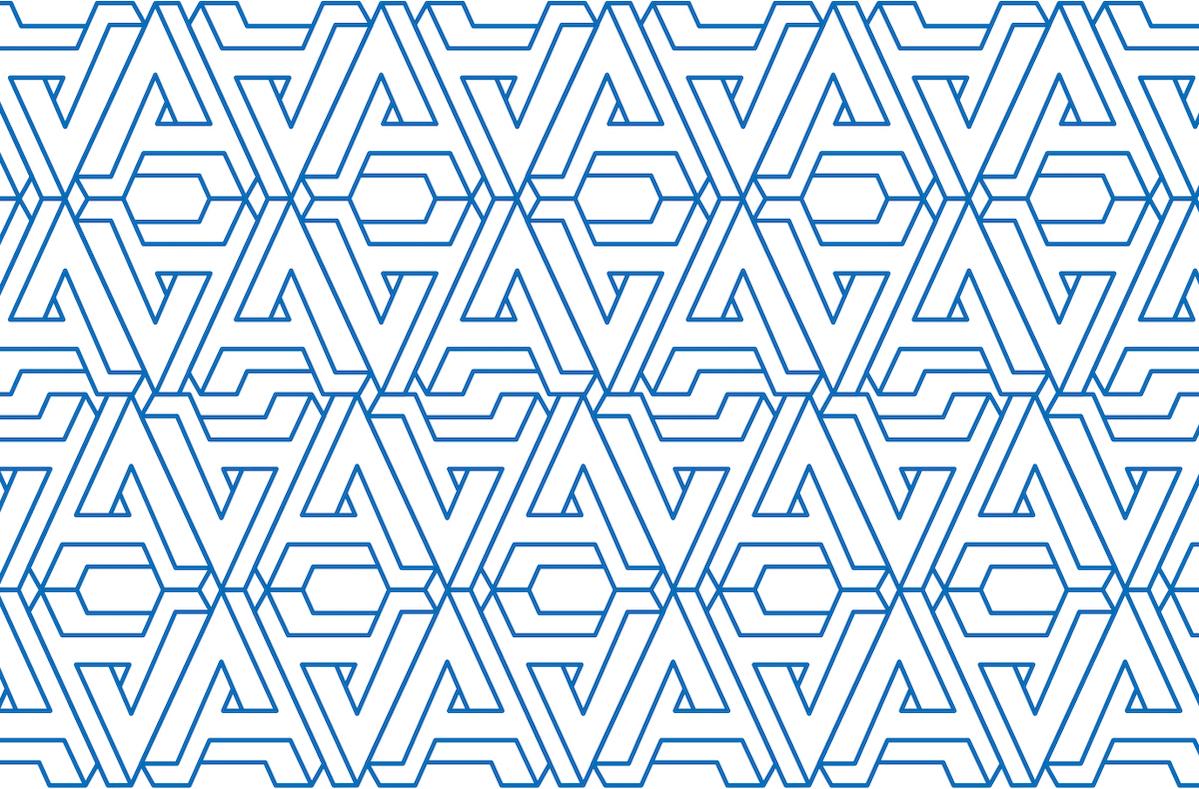
Catégorie
Date
Temps de lecture
CAA Paris 17 octobre 2012 société CBS Outdoor, req. n° 09PA03922
Poursuivant le feuilleton du régime contractuel des équipements de mobilier urbain, dont chaque épisode permet de retrouver les personnages clés que sont la société Decaux et la ville de Paris, la Cour administrative d’appel de Paris vient de se prononcer sur la nature de la convention conclue pour l’installation et l’exploitation des colonnes Morris.
L’utilisation du mobilier urbain que constituent les colonnes et les mâts porte-affiches[1] est réservée par des dispositions réglementaires[2] à l’annonce de spectacles ou de manifestations culturelles ou pour l’annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. Le contrat conclu entre la société Decaux et la ville de Paris prévoyait une utilisation de ces équipements conforme à ces dispositions, mais avec une réservation d’un certain nombre d’emplacements pour les annonces des théâtres, des cirques, et du cinéma d’art et d’essai. Ces annonceurs spécifiques devaient également bénéficier d’un tarif préférentiel, étant précisé cependant que le tarif de base comme le tarif préférentiel restaient à la libre fixation du cocontractant. Enfin, la ville de Paris devait donner son accord pour le choix des emplacements d’implantation de ce mobilier urbain, et disposait d’un pouvoir de contrôle de l’exécution du contrat.
Dans un premier temps, la cour censure l’approche du tribunal administratif de Paris qui avait qualifié ce contrat de délégation de service public, en retenant que l’activité confiée au cocontractant n’est pas un service public.
Rappelons qu’hors le cas des activités qualifiées par la loi de services publics, et hors le cas des activités d’intérêt général assorties de prérogatives de puissance public, le juge identifie l’existence d’un service public au moyen d’un faisceau d’indices tenant au contrôle exercé par la personne publique sur l’activité d’intérêt général considérée, et sur son implication dans la définition des caractéristiques et des contraintes du service[3]. Le juge recherche ainsi si la personne publique a entendu ériger ladite activité en service public à travers les exigences qu’elle impose : il recherche l’intention de la personne publique.
La cour estime que si l’activité d’annonce sur ces équipements urbains révèle une mission d’intérêt général, la ville de Paris n’a cependant pas entendu l’ériger en activité de service public :
« […] si cette convention peut être regardée comme faisant participer le cocontractant à une mission d’intérêt général consistant en la promotion d’activités culturelles sur le territoire parisien, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des stipulations précitées de la convention litigieuse, que la Ville de Paris aurait entendu ériger cette activité en service public ; qu’en particulier, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les contraintes imposées par la ville pour déterminer l’emplacement des colonnes et des mâts porte-affiches, ainsi que la part de ces éléments de mobilier urbain réservée, à des tarifs préférentiels, à l’annonce de certains spectacles, ne sauraient suffire à caractériser une telle intention ; qu’en effet, la convention laisse par ailleurs à la discrétion du cocontractant les modalités de choix et d’affichage des annonces ainsi que le niveau des tarifs applicables, préférentiels ou non ; qu’en outre, les modalités de contrôle et de sanction prévues par la convention, qui ont pour seul objet de permettre à la ville de s’assurer du respect des clauses de celle-ci, ne lui confèrent pas un droit de regard sur l’ensemble de l’activité exercée par la société JC Decaux dans le cadre de cette convention ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le fait que la convention en cause présenterait le caractère d’une délégation de service public pour annuler la délibération du 26 septembre 2005 […] ».
On notera que la liberté tarifaire dont bénéficie le cocontractant et les modalités de contrôle réservées au seul respect de l’obligation de réserver une partie du mobilier urbain aux annonceurs spécifiques (théâtre, cirque et cinéma d’art et d’essai), sans prévoir le contrôle des modalités d’exploitation de l’intégralité du mobilier urbain installé, a pesé dans l’appréciation conduite par le juge.
La cour admet donc que les personnes publiques puissent imposer des contraintes d’exécution d’un service sans que cela ne révèle une véritable activité de service public. Mais cette appréciation casuistique, si elle laisse un champ des possibles contractuels ouvert et souple, présente l’inconvénient d’une certaine insécurité juridique, puisqu’elle est susceptible de varier d’un juge à l’autre. Preuve en est que le tribunal avait au contraire considéré que ces mêmes clauses contractuelles révélaient une activité de service public de promotion culturelle[4].
On peut ici souligner que le refus de reconnaître une activité de service public aux activités dont le mobilier urbain est le support n’est pas nouveau : ainsi, les prestations de service rendues en matière d’information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries via l’installation d’abribus avait déjà été considérée comme ne constituant pas une activité de service public[5]. Pour autant, le Conseil d’Etat a pu qualifier d’activité de service public le « Vélib » parisien[6], mais sans doute parce que ce dispositif était directement destiné à offrir un service de transport au bénéfice des usagers.
Si l’intensité des contraintes d’exploitation imposées par la ville ne permet pas de retenir la qualification de service public, la cour va cependant considérer que ces contraintes révèlent que le contrat avait pour objet de répondre à un besoin public en matière de prestations de promotion d’activités culturelles :
« […] 10. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’exposé des motifs de la délibération contestée : ” (…) La volonté de pérenniser et de renforcer la promotion de l’ensemble de l’activité culturelle parisienne a conduit à apprécier dans le cadre de la consultation une proposition de tarification de l’affichage destinée à garantir une pluralité de représentation des différents acteurs culturels et notamment une tarification préférentielle au profit des théâtres (…)” ; qu’il résulte de ces motifs, ainsi que des stipulations précitées de la convention du 18 octobre 2005, qui fixent des contraintes dépassant, en tout état de cause, les obligations imposées par les articles 22 et 23 précités du décret du 21 novembre 1980 pour le type de mobilier urbain en cause et celles gouvernant, plus largement, l’occupation du domaine public, que l’objet de cette convention était, outre d’autoriser l’occupation en elle-même de ce domaine, de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la Ville de Paris pour la promotion d’activités culturelles ; qu’en particulier, alors que les stipulations de l’article 4 de la convention laissent à la ville le soin de déterminer, fût-ce en concertation avec son cocontractant, l’emplacement des éléments de mobilier urbain en cause, celles de l’article 10, dont il n’est aucunement démontré par la Ville de Paris qu’elles résulteraient de la seule volonté de la société JC Decaux, garantissent, en réservant aux théâtres, aux cirques et au cinéma d’art et d’essai une part substantielle des supports, à des tarifs préférentiels, la diversité de l’information délivrée et la promotion des activités spécifiques ainsi visées ; que, dès lors […] celle-ci doit être regardée comme ayant été conclue pour répondre aux besoins de la Ville de Paris, au sens des dispositions précitées du code des marchés publics […] »
Et – la société Decaux est bien placée pour le savoir – le caractère onéreux du contrat, nécessaire à sa qualification de marché, ressort de l’abandon des recettes d’exploitation publicitaire des équipements de mobiliers urbains considérés[7]. Partant, la cour retient la qualification de marché public, et censure le contrat conclu sans respecter les dispositions du code des marchés publics qui lui étaient applicables.
[1] Dénommées colonnes Morris en raison du nom de leur premier concessionnaire en 1868.
[2] Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, applicable au moment de la signature de la convention en 2005. Aujourd’hui, ces prescriptions sont codifiées aux articles R. 581-45 et R. 581-46 du code de l’environnement.
[3] CE Sect. 22 février 2007 Association du Personnel relevant des établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I.), req. n° 264541 : « Considérant qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission »
[4] « […] Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en décidant de promouvoir l’activité culturelle sur son territoire, en veillant à garantir, dans le même temps, par des tarifs préférentiels accordés aux théâtres, aux cirques et à certains cinémas de qualité, sur une part substantielle des supports, la diversité de l’information délivrée, la Ville de Paris doit être regardée comme ayant voulu conférer à cette mission de promotion le caractère d’un service public ; que le contrat conclu en vertu de la délibération attaquée avait ainsi pour objet de confier à un tiers la charge effective de l’exploitation de ce service ; qu’en effet, la part de l’affichage réservé, à des tarifs préférentiels, d’une part, aux théâtres et aux cirques, soit 250 colonnes, et, d’autre part, aux cinémas “d’art et essai”, soit 160 colonnes et 65 mâts, représente une part substantielle, soit environ 40 %, des mobiliers urbains disponibles, soit 550 colonnes et 700 mâts ; qu’en étant associé, par application des stipulations de l’article 4 dudit contrat, à la détermination de l’emplacement des mobiliers urbains en cause, ainsi qu’en disposant de toute latitude pour sélectionner le contenu de l’information culturelle, dans les conditions définies à l’article 10 de la convention, le cocontractant disposait d’un pouvoir d’organisation du service, sous le contrôle exercé par la Ville de Paris en vertu, notamment, des articles 22 et 23 […] » (TA Paris 24 avril 2009 société CBS Outdoor, req. n° 0516044/6-1
[5] CE 4 novembre 2005 société JC Decaux, req. n°247298 : publié au Rec. CE.
[7] CE 4 novembre 2005 société JC Decaux, req. n°247298 : publié au Rec. CE.
