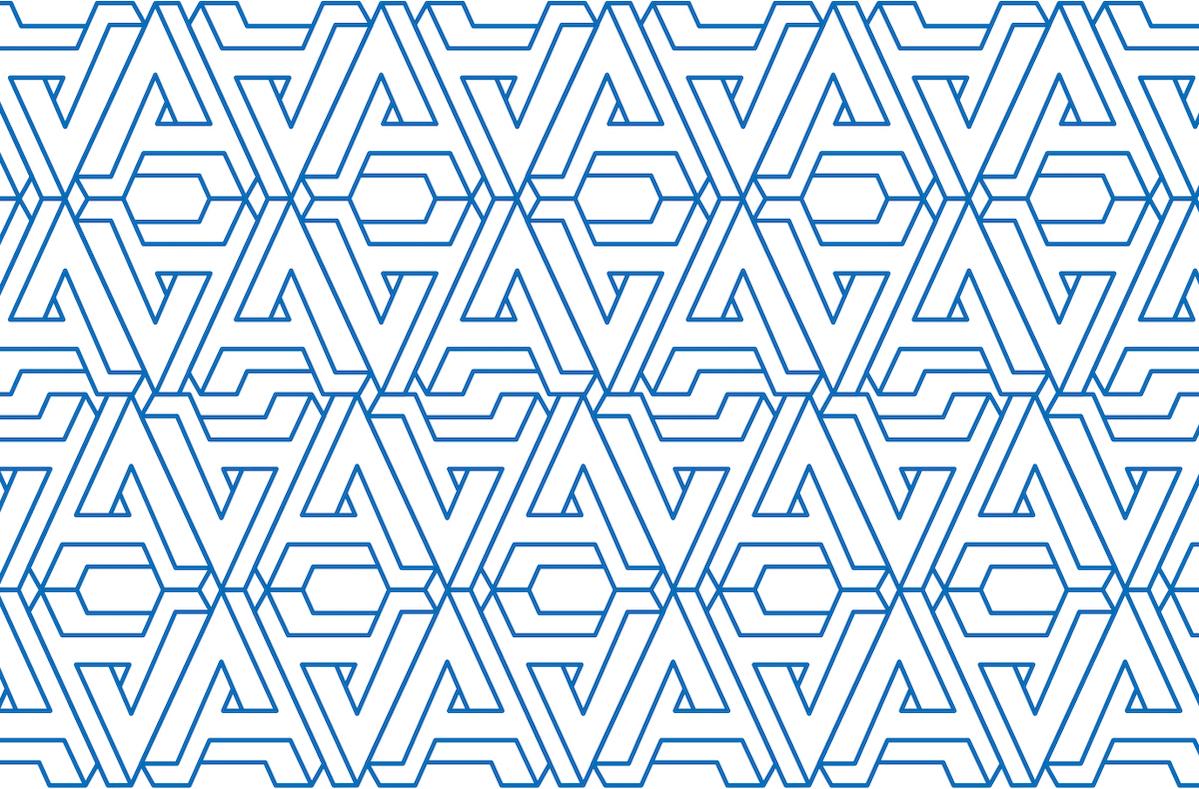Catégorie
Date
Temps de lecture
Par une décision rendue le 8 juillet dernier, le Conseil d’Etat est venu consacrer la possibilité, pour l’administration, d’imposer à un exploitant l’obtention d’une dérogation « espèces protégées », quand bien même l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux en cause auraient fait l’objet d’une autorisation environnementale devenue définitive et ne feraient pas l’objet d’une modification substantielle.
En l’espèce, le préfet de l’Aveyron a entendu fixer des prescriptions en cours d’exploitation à un parc éolien bénéficiant du régime de droits acquis au titre de la règlementation ICPE 1)Dans les conditions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, implanté dans le département, à la suite d’un avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie qui pointait l’impact significatif du parc sur l’avifaune du fait du risque de collision.
Le préfet de l’Aveyron a, dans un premier temps, prescrit à l’exploitant des mesures visant à préserver l’avifaune et les chiroptères, dont celle tenant à l’interdiction de fonctionnement diurne du parc éolien. Puis, par un second arrêté (celui attaqué), il a levé cette interdiction en l’assortissant de prescriptions complémentaires visant à la mise en place un système de détection et d’effarouchement afin de protéger neufs espèces protégées présentes sur le site.
La cour administrative de Toulouse, saisie par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) contre cet arrêté, a considéré que l’exploitant ne pouvait être contraint d’obtenir une dérogation espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement 2)Pour rappel, en application du 4° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement un dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code peut être délivrée « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.».
Plus précisément, les juges de fond ont considéré, d’une part, qu’une dérogation espèces protégées ne pouvait être accordée que sur demande du pétitionnaire présentée préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter et, d’autre part, que si une « adaptation à la dérogation » pouvait « être imposée par voie de prescriptions complémentaires en cours d’exploitation au titulaire d’une dérogation », il était nécessaire « qu’une telle dérogation ait été demandée et accordée à l’occasion de l’autorisation d’exploiter originelle » 3)CAA Toulouse 8 décembre 2022, req. n° 20TL22215.
Le parc éolien ne faisant l’objet, en l’espèce, d’aucune « modification substantielle » de ses caractéristiques, il n’y avait pas lieu, selon eux, de solliciter une nouvelle autorisation environnementale comportant une demande de dérogation 4)En effet, la CAA considère que « Il résulte des dispositions de l’article L. 181-14 citées au point 3 du présent arrêt qu’une distinction est opérée entre, d’une part, les modifications substantielles qui requièrent une nouvelle autorisation environnementale et qui, faisant perdre à l’exploitant les droits qu’il détenait de l’autorisation originelle, l’expose, si nécessaire, à devoir présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction ou d’altération des espèces protégées, s’il ne l’avait pas présentée préalablement à la délivrance de l’autorisation frappée de caducité et, d’autre part, les modifications de moindre ampleur qui n’appellent que des prescriptions additionnelles qui, hors les conditions qu’elles précisent ou renforcent, n’affectent pas les droits qui s’attachent à l’autorisation d’exploiter délivrée originellement. ».
Le Conseil d’Etat en a jugé différemment.
Faisant une application combinée des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement, la Haute assemblée a considéré que la législation en la matière imposait « à tout moment » la délivrance d’une dérogation « peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation ».
En outre, le Conseil d’Etat juge, contrairement à la CAA, que « Lorsque la modification de l’autorisation conduit l’autorité administrative à imposer des prescriptions complémentaires dont l’objet est d’assurer ou de renforcer la conservation d’espèces protégées », ces dispositions « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire dépendre la nécessité de l’obtention d’une dérogation ” espèces protégées ” de la circonstance que cette modification présenterait un caractère substantiel. »
Ce faisant, la Haute Assemblée considère qu’il appartient à l’autorité administrative, même en dehors de toute modification de l’autorisation (par exemple, comme dans le cas présent, au moment de la fixation de prescriptions complémentaires) de rechercher, lorsqu’il existe un « risque suffisamment caractérisé » pour les espèces protégées, d’imposer, s’il y a lieu, au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation et ce quand bien même l’autorisation environnementale présenterait un caractère définitif et que le risque ne résulterait pas d’une modification de l’autorisation 5) Appliqué au cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère alors « 13. Il suit de là qu’en relevant, pour juger inopérant le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 janvier 2020 ne pouvait intervenir sans la délivrance d’une dérogation ” espèces protégées “, que cet arrêté fixait des prescriptions complémentaires sans apporter de modification substantielle aux caractéristiques du parc éolien et, en conséquence, que la société CEPE de la Baume bénéficiait du droit, résultant du permis de construire, d’exploiter l’installation en étant dispensée de solliciter une telle dérogation, alors que ces prescriptions complémentaires avaient pour objet d’assurer la conservation d’espèces protégées, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit. ».
En outre, sans aller jusqu’à exiger une dérogation, il est jugé qu’il appartient également à l’autorité administrative de « prendre, à tout moment, à l’égard de l’exploitant, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de la nature et de l’environnement », telles que « les mesures de nature à préserver les espèces animales non domestiques protégées ainsi que leurs habitats » 6)Voir le point 4 de la décision.
En effet, comme cela ressort des conclusions du rapporteur public, Nicolas Agnoux, sous cette décision, l’efficience de la règlementation en matière de protection des espèces repose notamment sur la possibilité de pouvoir prendre en compte l’évolution de l’état de conservation des « espèces protégées » et de pallier aux éventuelles insuffisances des études qui ont été réalisées par le passé sans que l’exploitant puisse se prévaloir des droits acquis tirés de son autorisation environnementale initiale 7)« L’existence d’un risque suffisamment caractérisé est également susceptible d’être constatée postérieurement à la délivrance de l’autorisation et à la mise en service en raison, soit d’une évaluation initiale incomplète ou défaillante, comme c’était le cas ici, soit d’un changement de circonstances lié à une modification des installations ou à l’arrivée de nouveaux spécimens. S’y ajoute aussi la réévaluation des enjeux environnementaux résultant de l’évolution de l’état de conservation de certaines espèces ou la redéfinition des objectifs de protection, comme l’illustre ici encore le présent litige avec les plans de protection des vautours. […] Dans ce régime de “droit précaire” propre aux installations classées où les conditions d’exploitation doivent pouvoir être en permanence adaptées aux enjeux de sécurité et de protection de l’environnement, l’exploitant ne saurait en effet se prévaloir des droits acquis qu’il tire de l’autorisation environnementale initiale pour se soustraire à l’obligation de disposer d’une dérogation “espèces protégées” » (Conclusions de Nicolas Agnoux sous CE 8 juillet 2024 LPO, req. n°471174).
References
| 1. | ↑ | Dans les conditions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement |
| 2. | ↑ | Pour rappel, en application du 4° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement un dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code peut être délivrée « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.» |
| 3. | ↑ | CAA Toulouse 8 décembre 2022, req. n° 20TL22215 |
| 4. | ↑ | En effet, la CAA considère que « Il résulte des dispositions de l’article L. 181-14 citées au point 3 du présent arrêt qu’une distinction est opérée entre, d’une part, les modifications substantielles qui requièrent une nouvelle autorisation environnementale et qui, faisant perdre à l’exploitant les droits qu’il détenait de l’autorisation originelle, l’expose, si nécessaire, à devoir présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction ou d’altération des espèces protégées, s’il ne l’avait pas présentée préalablement à la délivrance de l’autorisation frappée de caducité et, d’autre part, les modifications de moindre ampleur qui n’appellent que des prescriptions additionnelles qui, hors les conditions qu’elles précisent ou renforcent, n’affectent pas les droits qui s’attachent à l’autorisation d’exploiter délivrée originellement. » |
| 5. | ↑ | Appliqué au cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère alors « 13. Il suit de là qu’en relevant, pour juger inopérant le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 janvier 2020 ne pouvait intervenir sans la délivrance d’une dérogation ” espèces protégées “, que cet arrêté fixait des prescriptions complémentaires sans apporter de modification substantielle aux caractéristiques du parc éolien et, en conséquence, que la société CEPE de la Baume bénéficiait du droit, résultant du permis de construire, d’exploiter l’installation en étant dispensée de solliciter une telle dérogation, alors que ces prescriptions complémentaires avaient pour objet d’assurer la conservation d’espèces protégées, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit. » |
| 6. | ↑ | Voir le point 4 de la décision |
| 7. | ↑ | « L’existence d’un risque suffisamment caractérisé est également susceptible d’être constatée postérieurement à la délivrance de l’autorisation et à la mise en service en raison, soit d’une évaluation initiale incomplète ou défaillante, comme c’était le cas ici, soit d’un changement de circonstances lié à une modification des installations ou à l’arrivée de nouveaux spécimens. S’y ajoute aussi la réévaluation des enjeux environnementaux résultant de l’évolution de l’état de conservation de certaines espèces ou la redéfinition des objectifs de protection, comme l’illustre ici encore le présent litige avec les plans de protection des vautours. […] Dans ce régime de “droit précaire” propre aux installations classées où les conditions d’exploitation doivent pouvoir être en permanence adaptées aux enjeux de sécurité et de protection de l’environnement, l’exploitant ne saurait en effet se prévaloir des droits acquis qu’il tire de l’autorisation environnementale initiale pour se soustraire à l’obligation de disposer d’une dérogation “espèces protégées” » (Conclusions de Nicolas Agnoux sous CE 8 juillet 2024 LPO, req. n°471174 |