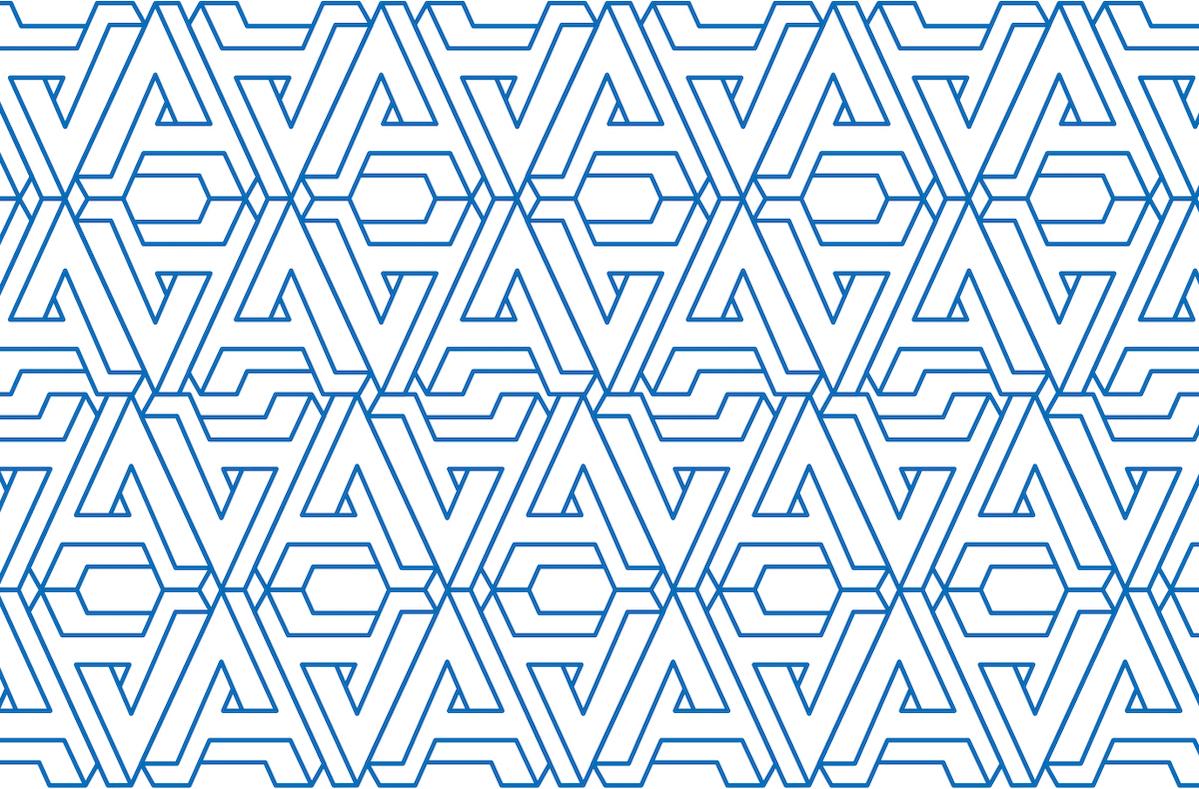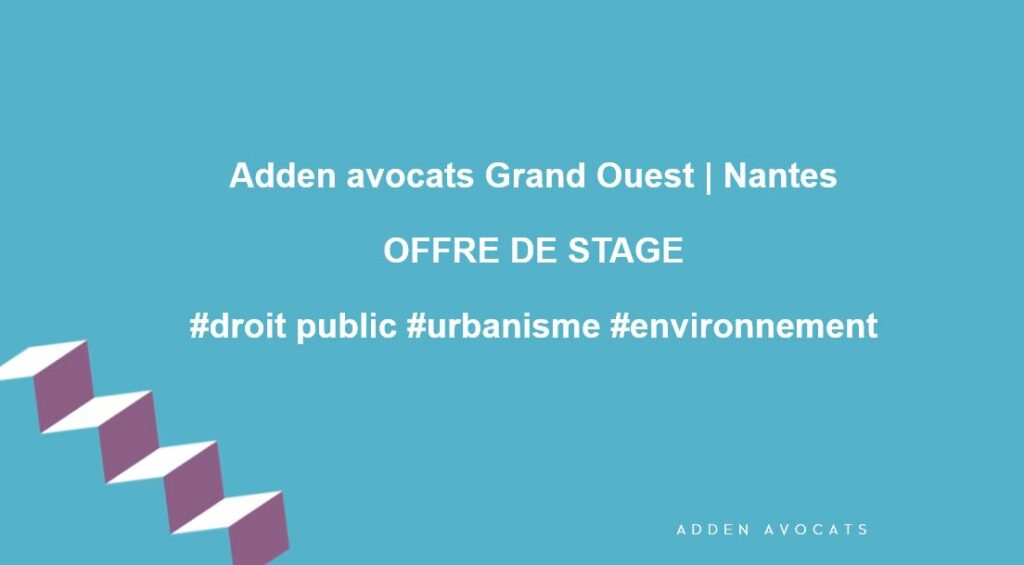Catégorie
Date
Temps de lecture
La décision du Conseil d’État du 18 novembre 2024 (CE 18 novembre 2024 Société Q Energy, req. n°487701 : Rec. T. CE) règle un point de procédure contentieuse portant sur la recevabilité d’une tierce opposition formée de voisins d’un projet lorsqu’une association défendant les habitants était déjà partie à l’instance (1). Mais surtout, le Conseil d’Etat poursuit son cheminement jurisprudentiel sur le contrôle de l’atteinte aux espèces protégées (2).
Une société s’était vu refuser un permis de construire et une autorisation d’exploiter un parc éolien par deux décisions du préfet de la Dordogne.
Après une requête infructueuse devant le tribunal administratif, la société avait interjeté appel et obtenu l’annulation du jugement litigieux. La cour administrative d’appel (CAA) avait usé de ses pouvoirs de pleine juridiction et délivré elle-même l’autorisation environnementale (laissant simplement au préfet le soin d’en fixer les conditions).
Cet arrêt a été contestés par une association, des communes ainsi que plusieurs riverains, qui ont demandé par la voie de la tierce opposition à ce que la CAA revienne sur sa décision accordant l’autorisation environnementale.
Par un arrêt du 27 juin 2023, la cour a fait droit à l’essentiel de leurs demandes et a notamment déclaré non avenu son précédent arrêt en tant que l’autorisation délivrée ne comportait pas la dérogation espèces protégées.
Par un pourvoi, la société Q Energy est venue aux droits de la société bénéficiaire de l’autorisation et a demandé l’annulation de l’arrêt du 27 juin 2023.
1. La tierce opposition
Cette société arguait d’abord que les riverains étaient irrecevables à former tierce opposition dès lors que l’association qui était déjà partie à l’instance les représentait.
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition est en effet réservée à ceux qui n’ont été ni présents ni représentés ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à la décision :
« Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
L’arrêt apporte sur ce point deux précisions.
D’une part, ainsi que le rappelle l’arrêt, il résulte de ce texte que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé. Mais, dans le cas particulier où c’est le juge lui-même qui accorde l’autorisation d’exploiter une installation classée (après annulation d’un refus d’autorisation), le Conseil d’Etat juge ici que la tierce opposition est ouverte « aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ».
Cette solution est justifiée par la nécessité de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et par les effets, sur les intérêts (mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement) protégés par le droit des installations classées, de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter.
D’autre part, il faut donc également que la personne formant tierce opposition n’ait pas été présente ou représentée dans l’instance contentieuse ayant abouti à la décision de justice qu’elle conteste. Or, au cas présent, l’association dont l’objet social est « la défense des conditions de vie des habitants » et « la mobilisation contre les projets d’installations industrielles portant de graves préjudices aux habitants riverains » était déjà partie à l’instance ayant conduit au premier arrêt de la CAA délivrant l’autorisation environnementale. Dès lors, pour la société Q Energy, les riverains étaient représentés dans l’instance ayant abouti à la décision qu’ils entendaient contester.
Si le rapporteur public Agnoux dans ses conclusions rappelle que « la représentation à l’instance peut découler d’une situation de fait caractérisée par l’existence d’ ‘’intérêts concordants’’ (CE 14 mai 2003, Beogradska Bank Ad Beograd, n° 238105, au recueil) », il conclut qu’en l’espèce les intérêts ne sont pas suffisamment concordants car l’objet social de l’association est très vaste, et surtout parce que dans le contentieux éolien, chaque situation individuelle est particulière, chaque riverain étant affecté de façon particulière.
Le Conseil d’État a suivi ce raisonnement et a jugé que des habitants situés à proximité immédiate d’un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu’il est susceptible d’occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l’objet statutaire inclut (notamment) la défense des conditions de vie des habitants d’une zone géographique particulière.
2. La dérogation « espèces protégées »
Le second moyen du pourvoi tenait aux motifs de l’arrêt par lesquels la cour a estimé que le projet présentait un risque suffisamment caractérisé pour une espèce protégée et nécessitait donc une dérogation au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Dans un considérant très clair, le Conseil d’Etat rappelle les principes consacrés par son avis Sud-Artois 1)CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, req. n° 463563, p. 403. et les explicite :
« 7. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation ” espèces protégées ” si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation ” espèces protégées “. Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. »
L’arrêt attaqué annulait l’autorisation environnementale en tant qu’elle ne contenait pas de dérogation « espèce protégée ». Le Conseil d’Etat valide la méthode retenue par la Cour pour contrôler l’atteinte caractérisée aux espèces protégées d’avifaune, mais considère que, pour deux espèces d’oiseaux et les chiroptères, les motifs fondant la nécessité d’une telle dérogation étaient erronés.
Dès lors, fallait-il rejeter le pourvoi (puisque la nécessité d’une dérogation était avérée pour certaines espèces) ou bien annuler partiellement ou totalement l’article 2 de l’arrêt annulant l’autorisation environnementale pour absence de dérogation espèces protégées, au motif qu’il l’exigeait pour des espèces ne la nécessitant pas ?
Le rapporteur public Agnoux a préconisé une annulation de l’ensemble de l’article 2 de l’arrêt, en retenant notamment « une approche globale » de la dérogation espèces protégées nécessaire à un projet, dont un vice ou une erreur appellerait une censure globale.
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État en annulant tout l’article 2 de l’arrêt qui annulait l’autorisation environnementale au motif de l’absence de dérogation « espèce protégée », jugeant par-là implicitement que cette dérogation est « indivisible », et en renvoyant l’affaire à la CAA de Bordeaux qui ne pourra que retenir la nécessité d’une dérogation « espèce protégée » pour les quatre espèces d’oiseaux à l’égard desquelles le risque d’atteinte a été suffisamment caractérisé.
References
| 1. | ↑ | CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, req. n° 463563, p. 403. |