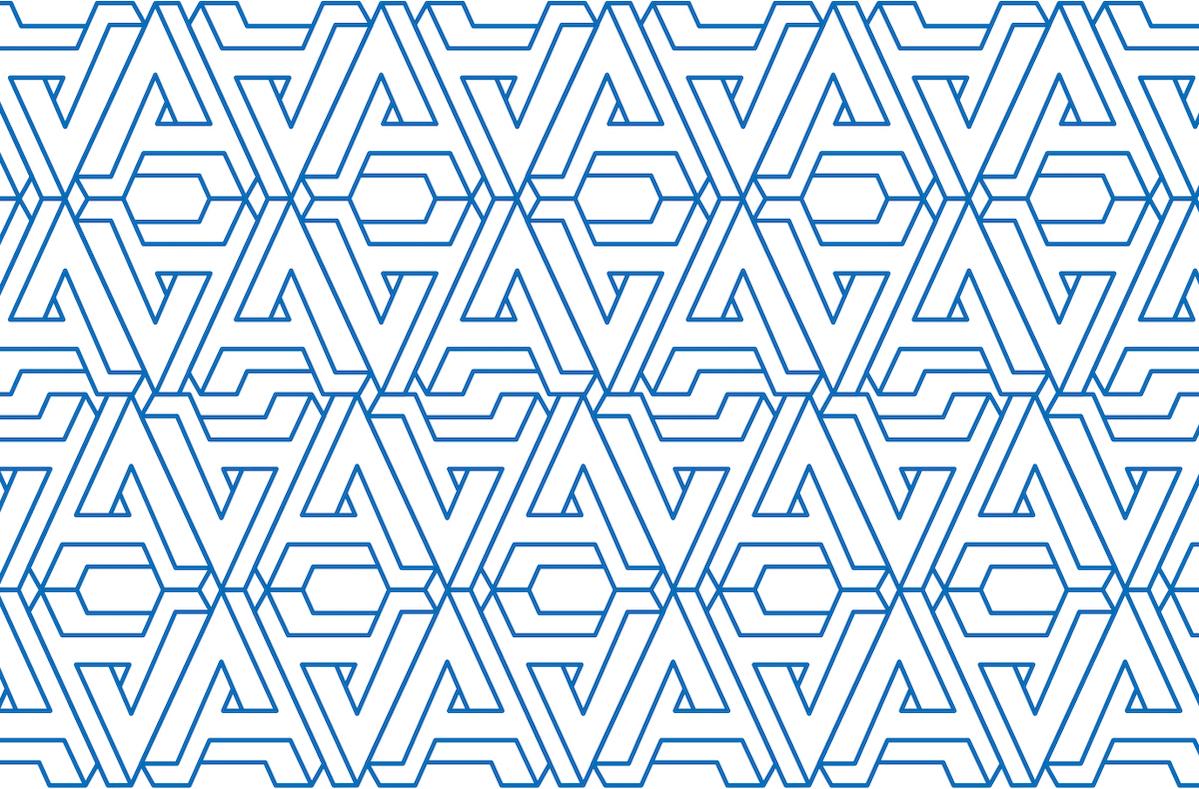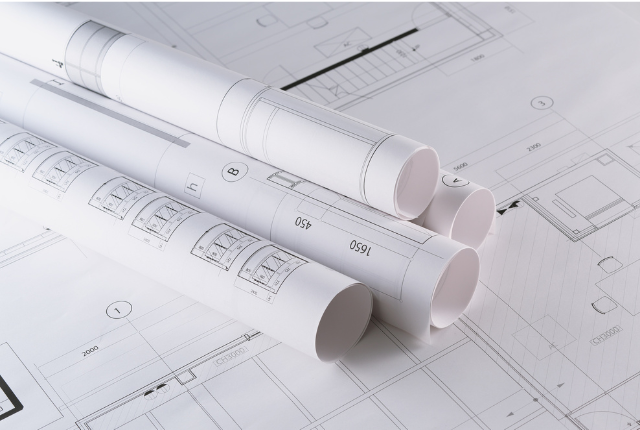Catégorie
Date
Temps de lecture
CE 8 juillet 2024, req. n° 475635 : mentionné aux T. Rec. CE
Dans cette affaire, la SCI Mousseau a obtenu un permis de construire le 10 décembre 2020 et un permis modificatif le 12 mai 2021, pour la réhabilitation d’un immeuble en R+4 sur rue sis 131 boulevard Saint-Michel à Paris, et la construction de deux immeubles en R+3 sur cour à la place d’anciens locaux. Des voisins ont contesté ces arrêtés de permis.
C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat d’apporter des précisions intéressantes sur (1) la détermination de la destination de l’immeuble et l’article UG 2.2.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris et (2) l’article UG 13.1.2 sur les espaces de pleine terre.
1 Sur la détermination de la destination de l’immeuble et l’application de l’article UG 2.2.1 du PLU de Paris
C’est essentiellement sur ce premier moyen que porte le débat devant le Conseil d’Etat, saisi par la Ville de Paris et la société pétitionnaire.
Tout d’abord, il faut rappeler que l’article UG 2.2.1 du PLU de Paris prévoit que, dans le secteur de protection de l’habitation (où se trouve le projet litigieux), la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle après travaux, notée « SPH », ne doit pas être inférieure à celle avant travaux ; étant précisé que la SPH comprend les surfaces de plancher destinées à l’habitation et aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (« CINASPIC »).
Il convient donc, pour l’application de cette règle, d’être en mesure de déterminer la destination des locaux avant travaux – ce qui n’est pas toujours évident lorsque, comme en l’espèce, l’immeuble est ancien et qu’aucune autorisation d’urbanisme ne permet d’en déterminer la destination.
Le Conseil d’Etat vient donner le mode d’emploi :
« Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce ».
Ainsi, le Conseil d’Etat valide en l’espèce l’appréciation souveraine de la cour administrative d’appel de Paris qui a retenu, pour les locaux sur cour destinés à être démolis puis reconstruits, la destination de CINASPIC et non plus la destination industrielle initiale.
En effet, le juge d’appel a considéré que :
- si ces locaux ont été conçus comme des ateliers au 19 siècle et d’abord utilisés, dans un premier temps, par une imprimerie ;
- ils ont, par la suite, été affectés à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de 1984 à 2015, soit pendant plus de 30 ans ;
- et dès lors que l’usage de ces locaux sur une période longue était dévolu à un établissement universitaire, ils devaient relever de la destination CINASPIC au sens du PLU de Paris.
Ainsi, ces locaux devaient bien être pris en compte au titre des surfaces liées à la fonction résidentielle pour l’application du 2° de l’article UG 2.2.1 du PLU, et la destruction de cette SPH aurait dû être compensée.
C’est sur ce point de droit que l’arrêt est fiché au Recueil du Conseil d’Etat.
Pour résumer, pour déterminer la destination d’un immeuble :
- il convient donc, dans un premier temps, se référer à la destination juridique de l’immeuble au regard des autorisations d’urbanisme délivrées et mises en œuvre, indépendamment de ce qui pourrait être écrit dans un contrat de droit privé tel qu’un bail 1)CE 12 mars 2012 Commune de Ramatuelle, req n° 336263 .
- à défaut d’une telle autorisation, il faut, dans un second temps, regarder les caractéristiques propres des locaux sous réserve qu’elles permettent d’identifier un seul type d’affectation pour ces locaux 2)Le juge administratif considère en effet que la circonstance qu’une construction soit restée inoccupée, même pendant une longue période, n’est pas, par elle-même, de nature à en changer la destination si elle en a conservé les caractéristiques propres (CE 9 décembre 2011, req. n° 335707 – commenté sur le blog) ;
- si les caractéristiques propres des locaux ne permettent pas de déterminer un seul type d’affectation, il convient alors, dans un troisième temps, de regarder les circonstances de fait (et il appartiendra au juge, dans un tel cas, d’apprécier si ces éléments permettent de déterminer la destination des locaux).
C’est ainsi que, comme l’a relevé le rapporteur public, M. Laurent Domingo 3)Conclusions du rapporteur public, M. Laurent Domingo, sous l’arrêt commenté, la cour a pu raisonner en ne s’en tenant pas à la situation existante il y a 100 ans mais en regardant l’activité effective exercée dans les locaux et son caractère suffisamment établie dans la durée pour en tirer une qualification au regard de la définition des CINASPIC par le PLU de Paris.
2 Sur la notion de pleine terre et la méconnaissance de l’article UG 13.1.2 du PLU de Paris
Outre la question de la destination, cette affaire est également l’occasion, pour le Conseil d’Etat, d’apporter des précisions sur la notion d’espaces de pleine terre pour l’application de l’article UG 13.1.2 du règlement du PLU de Paris.
Pour rappel, l’article UG 13.1.2 prévoit des obligations d’espaces libres, de plantations et de végétalisation du bâti. Notamment, tout terrain doit comprendre, au titre de ces espaces libres, 20% de surface de pleine terre.
Il ressort du lexique du PLU de Paris qu’un espace est considéré comme de pleine terre « lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique ».
Le Conseil d’Etat vient ici préciser la définition en précisant « qu’une surface de pleine terre suppose une absence d’atteinte à l’équilibre pédologique du sol et une perméabilité permettant le raccordement du sous-sol à la nappe phréatique, mais aussi un traitement naturel de la surface, sans revêtement hormis le stabilisé ». Aussi, il considère qu’un chemin piétonnier recouvert de pavés béton perméables, que la société Mousseau a inclus dans les espaces de pleine terre, constitue en réalité une surface au sol artificialisée, qui ne peut être regardée comme constituant un espace de pleine terre, et que le permis méconnaissait, à cet égard, l’article UG 13.1.2 du PLU.
Les pourvois de la Ville de Paris et de la société Mousseau sont, par conséquent, rejetés et la société pétitionnaire est tenue de notifier un nouveau permis de construire régularisant les deux vices précités.
References
| 1. | ↑ | CE 12 mars 2012 Commune de Ramatuelle, req n° 336263 |
| 2. | ↑ | Le juge administratif considère en effet que la circonstance qu’une construction soit restée inoccupée, même pendant une longue période, n’est pas, par elle-même, de nature à en changer la destination si elle en a conservé les caractéristiques propres (CE 9 décembre 2011, req. n° 335707 – commenté sur le blog |
| 3. | ↑ | Conclusions du rapporteur public, M. Laurent Domingo, sous l’arrêt commenté |